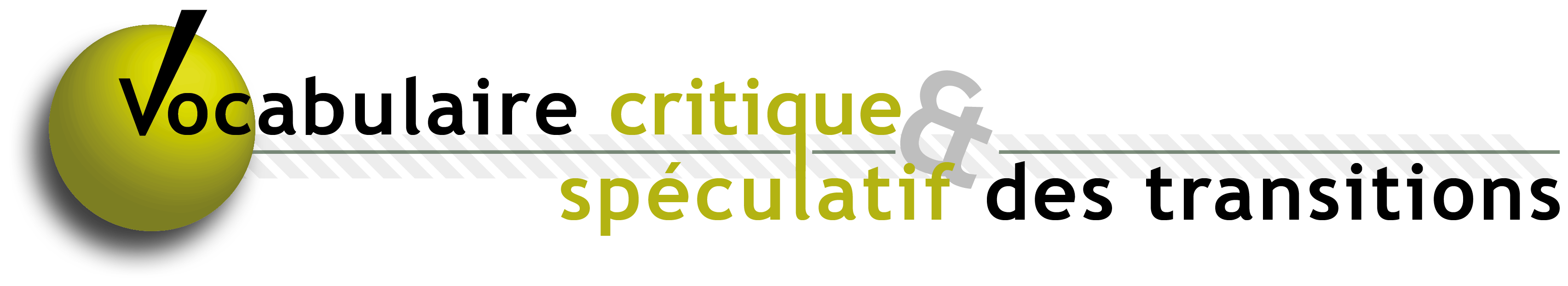OFB et polices de l’environnement : le désarmement du droit
François Jarrige
Yannick Sencébé
Le début de l’année 2025 a été marqué par une nouvelle série d’attaques à l’égard des agents en charge d’appliquer les réglementations environnementales, illustration parmi d’autres du « backlash » écologique en cours et des régressions délibérées, au plus haut sommet de l’État, à l’égard du processus d’écologisation de l’agriculture et des politiques de transition environnementale, pourtant rares et limitées. Relayant les discours des organisations syndicales agricoles productivistes, le Premier ministre François Bayrou n’a pas hésité à mettre de nouveau en cause, dans son discours de politique générale du 14 janvier 2025, l’action « des inspecteurs de la biodiversité » accusés d’humilier les agriculteurs par leurs contrôles excessifs. Parallèlement, des bureaux de l’Office français de la biodiversité (OFB) étaient une fois encore pris pour cibles par des actions de la Coordination rurale (CR), de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) et des Jeunes agriculteurs (JA) dans plusieurs départements, conduisant à une grève historique des quelques 3 000 agents de l’OFB, parmi lesquels on trouve les 1 700 inspecteurs de l’environnement en charge de l’application de la réglementation environnementale.
Figure 1.
Manifestation des inspecteurs de l’OFB soutenus par plusieurs élus de gauche et quelques militants écologistes, le vendredi matin 31 janvier 2025 devant la préfecture, à Dijon.

Photo Le Bien Public / Bertrand Lhote [1].
Ces évènements sont le dernier avatar d’une longue série de revers et de remises en cause du droit de l’environnement qui s’inscrit au cœur des ambivalences actuelles de la transition écologique sans cesse célébrée et annoncée, mais toujours repoussée. Il y a un an, le Premier ministre macronien d’alors, Gabriel Attal, se demandait « s’il faut vraiment venir armé quand on vient contrôler une haie ? ». Le ministre ne doit pas souvent prendre le métro et assister à des contrôles d’identité (faut-il une mitraillette pour contrôler une pièce d’identité ou généraliser l’armement de la police municipale ?). Il n’a peut-être pas non plus consulté les statistiques officielles qui font apparaître une perte de 70 % du linéaire de haies depuis 1950 [2], à un rythme qui se poursuit à hauteur de 23 500 km/an dans la période 2017-2021 alors même que 45 millions d’euros de subventions publiques ont été débloqués (programme « Plantons des haies ! » du plan France Relance) pour une ambition de 7 000 km seulement entre 2021 et 2024. Le ministre n’a pas dû non plus aller sur le terrain à la rencontre des agriculteurs concernés qui ne paraissent pas souffrir outre mesure de la menace du gendarme OFB. Ceux que nous avons rencontrés [3] sur le sujet ont compris que les contrôles de l’OFB sont rares et qu’il est possible de « mettre un petit coup de godet » sur des tronçons distincts pour supprimer quelques mètres de haies gênants, sans risque de retombées réglementaires. Certains indiquent même que la loi « n’est pas dure à contourner si on s’y prend correctement ». La question n’est donc pas de savoir si les agents de l’OFB ont besoin d’armes (dont le port remonte aux garde-chasses depuis le xixe siècle) pour contrôler les exploitations, mais s’ils sont en nombre suffisant pour remplir leur mission – rappelons qu’ils ne sont que 1 700 agents pour l’ensemble du territoire qui s’occupent à la fois de la chasse, de la protection des zones humides et de la qualité de l’eau.
À la suite des manifestations agricoles du début de l’année 2024, et de la montée incessante des critiques à l’égard de « l’écologie punitive », devenues un réflexe dans les discours de la droite sur les questions environnementales, le Sénat avait rendu en septembre 2024 un rapport d’information qui suggérait notamment de « dépénaliser certaines infractions environnementales » et de réduire encore le rôle des inspecteurs de l’environnement en privilégiant particulièrement leurs missions de prévention [4]. Rédigé par le sénateur Jean Bacci, élu LR du Var, proche de Bruno Retailleau dont il soutient par ailleurs le projet sécuritaire et répressif, ce rapport est une étape de plus dans l’affaiblissement des régulations environnementales ces dernières années. C’est pourquoi l’OFB fait l’objet de critiques incessantes depuis un an jusqu’à devenir un bouc émissaire commode : il serait trop peu présent sur le territoire, dénoncé comme ignorant des réalités du monde rural et agricole, voire adoptant des positions « militantes ».
Ce rapport reflète les impasses des politiques environnementales actuelles et le double discours qui consiste à faire de la protection de l’environnement et de la biodiversité une priorité des politiques publiques sans jamais donner réellement les moyens de les mettre en œuvre. Les sénateurs constatent le « déficit de légitimité » qui caractériserait l’établissement, mais cette accusation d’illégitimité a elle-même été construite par des élites politiques soucieuses de préserver la croissance et le modèle industriel dominant, contre toute velléité d’encadrement et de régulation des activités toxiques. Alors que s’affirme pourtant l’urgence de désarmer les intérêts privés et les branches d’activités à l’origine des crises environnementales, l’État macronien et ses alliés conservateurs tendent à affaiblir les quelques institutions dédiées à la protection de l’environnement et à la répression des infractions environnementales, telles que l’Office français de la biodiversité. Cette institution reste plus que jamais sous le feu continu des critiques des partisans de l’agriculture industrielle – Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) et acteurs de l’agro-industrie en tête. Parallèlement, des députés de droite comme Éric Ciotti et Laurent Wauquiez appellent tout simplement à la suppression de l’OFB [5]. Ce dernier, dans un courrier adressé aux agriculteur·rices de la région Rhône-Alpes en date du 7 février 2025, n’hésite d’ailleurs pas à attaquer directement l’OFB au motif qu’il« empêcherait [les agriculteurs] de travailler sereinement, en [les] accablant de contrôles absurdes ». Qualifié de « coalition d’idéologues », l’OFB est purement et simplement décrédibilisé, sa dissolution explicitement souhaitée [6]. Comment ne pas s’inquiéter que de tels propos puissent être tenus de manière aussi décomplexée ?
Impunités environnementales
Ce contexte de régression apparente des normes environnementales et des « polices » de l’environnement, loin d’être neuf, est au cœur du fonctionnement du capitalisme industriel depuis ses débuts. Pour se déployer, celui-ci n’a pas cessé de lever les inquiétudes et les efforts de régulation anciens portés par des riverains, voisins des installations industrielles classées, ou les communautés locales soucieuses de préserver leurs milieux de vie [7]. L’histoire de l’expansion industrielle est celle de phases où alternent de façon discontinue des efforts et des tentatives pour encadrer et réguler les activités jugées toxiques ou dangereuses, et des moments d’acceptation de ces risques au nom du « progrès », de la croissance, de la compétition internationale ou de la souveraineté, qu’elle soit alimentaire, industrielle ou énergétique [8].
Le mot « police » lui-même est ambivalent et a fluctué. La notion, héritée de l’Antiquité, désigne d’abord le droit de certaines communautés urbaines de s’administrer en se dotant de normes et de règles concernant ce qui a trait aux rapports sociaux dans l’espace urbain, à la fois l’ordre public, bien sûr, mais aussi l’ordre environnemental, que ce soit la propreté des rues, l’organisation des marchés, les rejets à la périphérie des activités des artisans, etc. C’est ainsi que l’on parle de police des marchés, des métiers, des poids et mesures, des jeux, etc. Sous l’Ancien Régime, le pouvoir dit de police est d’abord exercé par les conseils municipaux (consuls ou échevins), à l’exception de Paris, jugée particulièrement sensible sur le plan politique et qui perd cette compétence dès le xviie siècle au profit d’un officier du roi, appelé lieutenant-général de police. Au cours du xixe siècle, ce régime est étendu à Lyon et Marseille, qui sont dotées de « préfets de police » sous le contrôle du pouvoir central, tandis qu’une direction de la police est créée au ministère de l’Intérieur. De plus en plus contrôlée par l’État, la police devient un outil de répression centralisé plutôt qu’une institution d’auto-organisation locale. Les polices se diversifient selon leurs champs de compétences alors que leurs effectifs explosent. La police dite nationale et la gendarmerie ont ainsi pour missions le maintien de l’ordre et la recherche des infractions, essentiellement judiciaires, énumérées dans le Code pénal.
Aujourd’hui, à côté du droit civil et pénal chargé de réguler les relations entre individus, s’affirme aussi de plus en plus un droit dit de l’environnement qui encadre la protection, l’utilisation, la gestion ou la restauration des écosystèmes. La réparation de dommages environnementaux a, là encore, une longue histoire et s’inscrit dans un ensemble de normes anciennes. Celles-ci sont plus en plus techniques et complexes, locales et globales, et elles connaissent une expansion rapide alors que leurs périmètres tendent à se densifier et à se diversifier au fur et à mesure des évolutions économiques, scientifiques et techniques qui ne cessent de complexifier les relations que les sociétés contemporaines entretiennent avec leurs milieux de vie et les autres qu’humains. Ce droit singulier se matérialise par ailleurs dans un Code de l’environnement, mais sans forcément disposer de juridiction spécialisée (comme il existe par exemple un juge à l’enfance, ou une spécialité criminelle, antiterroriste, etc.) ni de moyen réel d’application.
Actuellement, sur le plan pénal, les pollueurs et ceux qui portent atteinte à l’environnement sont très rarement poursuivis en correctionnelle et l’administration privilégie les régularisations aux sanctions alors que s’installe un véritable « renoncement écologique » malgré les annonces [9]. En France en particulier, les activités susceptibles de porter atteinte à l’environnement restent principalement régies par des régimes de police administrative selon les logiques qui se sont installées dès le xixe siècle afin de contrer les jurisprudences favorables aux riverains affectés par les premières usines, qui menaçaient de freiner le processus d’industrialisation. Le juge pénal est peu à peu dépossédé de son pouvoir d’appréciation au profit de l’administration, laquelle est désormais chargée de fixer seule – sous le contrôle du juge administratif – le niveau de pollution et de destruction admissible. Ainsi, le « régime de police des installations classées, dont les principes ont ensuite été étendus en matière de déchets ou d’eau, a consacré le juge administratif comme principal juge de l’environnement, laissant au juge judiciaire, et notamment pénal, une compétence résiduelle [10] ».
De nos jours, les atteintes à l’environnement sont encore prises en charge à travers divers régimes de police spéciaux : les installations classées, les déchets, l’eau et la nature. Si certains juges portent une attention croissante au sujet de l’environnement, particulièrement technique et complexe, parce que relevant d’une expertise scientifique, l’impunité continue de l’emporter alors que les peines demeurent très réduites. Les industriels et les pollueurs savent en outre que les règles peuvent être contournées ou négociées, et qu’en l’absence de recours des tiers, le statu quoest généralement toléré par l’administration. Ainsi, sur les 500 000 installations industrielles classées en France, dont 1 312 classées Seveso, et 50 000 soumises à l’autorisation ou l’enregistrement, très peu sont effectivement surveillées et régulées en dépit des complaintes sur la surcharge de règles et l’état répressif en matière environnementale. La réalité est que pour surveiller ces activités potentiellement dangereuses, et malgré les promesses qui ont suivi la catastrophe de Lubrizol en septembre 2019, le nombre d’inspecteurs stagne : il s’élevait à 1 587 en 2022, contre 1 607 en 2018. Dans le même temps, le nombre d’inspections effectives a baissé de 40 % entre 2006 et 2018, passant de 30 040 à 18 196. Les historiens de l’environnement ont montré depuis longtemps combien les régulations environnementales étaient peu et mal appliquées. Les débats actuels sur l’OFB s’inscrivent dans la continuité de deux siècles de construction historique de l’impunité environnementale.
Par ailleurs, la surveillance reste généralement une illusion, notamment pour les industries chimiques, dont la gamme de produits évolue plus rapidement que la réglementation, comme l’ont montré récemment les scandales des « polluants éternels » (PFAS) ou les débats récurrents sur les pesticides et leur interdiction. Quant aux sanctions administratives ou pénales, elles sont toujours faibles ou inopérantes. Ainsi Thomas Le Roux observe que « seuls 10 % des arrêtés préfectoraux constatant une infraction dans le cadre des mises en demeure sont suivis d’une sanction pénale, et il s’agit généralement d’amendes très faiblement coercitives et inefficacement compensées par l’astreinte administrative, une amende journalière jusqu’à la mise en conformité, ou la transaction pénale – toutes deux procédures qui financiarisent le risque en quelque sorte [11] ». Notons que si les responsables d’AZF ont fini par être condamnés (avec une peine bien légère de 15 mois de prison avec sursis pour le directeur), le dénouement du procès, en décembre 2019, a eu lieu plus de 18 ans après la catastrophe ; et la tenue d’un procès pénal pour l’accident de Lubrizol est très incertaine. Hors de ces catastrophes, la prééminence de la régularisation sur la sanction se fait aux dépens des tiers et interroge sur l’effectivité du droit de l’environnement, à l’image des autres illégalismes environnementaux découlant d’une police sans moyens, d’une priorité donnée aux impératifs économiques, d’une pratique menant aux procédures transactionnelles et d’une culture juridique vide de préoccupations environnementales, même si aujourd’hui se dessinent sans doute des changements avec le renouvellement générationnel des magistrats, plus sensibles et sans doute mieux formés à ces sujets [12].
Une « police de l’impossible »
Alors même que les polices municipales et criminelles se portent bien, avec des budgets et des effectifs en hausse, et que s’affirme le tout répressif pour les migrants, la petite délinquance de banlieue ou les militants écologistes, la clémence et l’assouplissement des règles continuent de guider l’action de l’État à l’égard des industriels et agriculteurs pollueurs. Si certains délits comme la conduite sous emprise de stupéfiant et de cannabis ont explosé ces 20 dernières années, passant de moins de 3 000 condamnations en 2005 à plus de 57 000 en 2021, les délits environnementaux – défrichements illicites, rejets de substances toxiques dans le milieu, braconnage – restent quant à eux peu poursuivis.
L’histoire de l’OFB et des « polices environnementales » est à cet égard éclairante. Cet office a été créé en 2020 par la réunion, au sein d’un même établissement, des anciennes polices historiques de la pêche et de la chasse, devenues les polices de l’eau et de la nature. On distingue en effet deux types de polices dites de l’environnement : « eau et nature » et « installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ». Les polices de l’environnement regroupent pour l’essentiel les agents administratifs chargés de contrôler et de faire respecter les réglementations, mais également de constater les infractions pénalement punissables en matière environnementale. Peu visibles et peu connues, ces institutions regroupent les agents de l’Office français pour la biodiversité en charge de la police de l’eau et des milieux aquatiques, des milieux naturels, des espèces sauvages, de la pêche et de la chasse, ainsi que les polices des installations classées et des établissements industriels rattachés à des services comme la Direction départementale des territoires (DDT) ou la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL). Leurs compétences sont définies par le Code de l’environnement [13]. Dans ces divers services, les inspecteurs de l’environnement sont des agents de service public assermentés et habilités dans le cadre de la législation environnementale à conduire les missions de police de l’environnement, c’est-à-dire le constat et la répression des infractions éventuelles.
Le succès administratif des notions comme « environnement » à partir des années 1970, ou comme « biodiversité » dans les années 2000 dissimule en réalité une continuité dans les pratiques et les institutions qui encadrent les usages de la nature et qui privilégient toujours massivement la pédagogie et les rappels aux règlements sur les sanctions réelles. L’essor de cette police est censé prouver l’écologisation de l’État et de ses politiques, qui se doteraient de moyens pour faire appliquer des réglementations jusqu’à présent restées lettre morte. Pourtant, cette police demeure très faible du fait notamment des effectifs restreints déjà pointés et d’une série de contraintes qui entravent son action ; en bref, il s’agit largement d’une « police de l’impossible », comme le montrent de nouveau les attaques répétées contre l’OFB [14].
Une enquête récente en particulier a montré les difficultés qui entravent l’action régulatrice et répressive de cet organisme alors que les pénalités environnementales demeurent le parent pauvre de la justice. Les contraintes qui pèsent sur l’action des agents de l’OFB chargés de faire appliquer le droit de l’environnement sont en effet nombreuses : faiblesse des moyens, effectifs insuffisants voire en baisse, entraves multiples de la part de certains élus locaux ou syndicats agricoles [15]. On pourrait parler à cet égard d’une fabrique réglementaire et organisationnelle de son impuissance d’agir. C’est ce qui apparaît à la lecture du bilan publié le 5 juin 2024 par le syndicat de la magistrature auprès de la mission d’information du Sénat. Le constat partagé par les magistrats et rendu public lors de son congrès est le suivant : « la justice est rendue impuissante face aux atteintes à l’environnement, en étant dépossédée, au profit de l’administration, de l’application de ce droit ». Les magistrats s’accordent sur la grande compétence des inspecteurs de l’environnement de l’OFB dont les procès-verbaux sont précis, rigoureux, circonstanciés et pédagogiques (en l’absence de spécialisation environnementale des juges, cet appui est essentiel). Mais ils regrettent le caractère hybride de leurs missions, qui rendent impossible une véritable police de l’environnement : « Il n’est pas raisonnable […] d’attendre des mêmes acteurs à la fois de la pédagogie et du contrôle impartial, de la recherche scientifique et du conseil aux collectivités territoriales ; ce n’est ainsi pas le cas pour la gendarmerie et la police nationale. » Le niveau des effectifs de l’OFB est jugé très insuffisant pour accomplir toutes ses missions et intervenir en temps réel en cas d’infraction, d’autant que, contrairement aux autres polices, les agents n’ont aucune astreinte de nuit ou de week-end. L’OFB détient donc des pouvoirs de police sans en avoir les moyens.
Par ailleurs, les critiques et les entraves apportées à l’action des polices de l’environnement, dépeintes comme le bras armé d’un État oppressif à l’égard du monde agricole, s’inscrivent dans le double contexte d’un supposé « agribashing » et de la répression des mouvements écologistes [16]. Après avoir réprimé et marginalisé toute critique écologiste radicale dans l’espace public, il s’agit d’affaiblir les quelques outils dont l’État s’était dotés au début du xxie siècle pour tenter de faire appliquer le droit de l’environnement émergeant. Les bilans chiffrés démontrent d’ailleurs qu’on est très loin du harcèlement dénoncé dans les médias par les porte-parole du productivisme agricole et leurs relais politiques. « En 2023, sur les 21 635 contrôles administratifs réalisés par l’OFB, seulement 2 759 concernaient des agriculteurs, soit moins de 13 % des cas. À ce rythme, avec une moyenne de 17 agents par département, la direction de l’OFB estime qu’un agriculteur français risque d’être contrôlé une fois tous les 130 ans », indique par exemple l’EFA-CGC, syndicat de l’environnement, la forêt et l’agriculture qui représente les personnels des ministères de l’Agriculture et de l’Écologie et de leurs établissements associés. Quant aux contrôles judiciaires, le syndicat a recensé 1 273 procédures concernant le monde agricole en 2023, soit 13 procès-verbaux par an et par département en moyenne [17].
Si le « pacte vert » européen prévoit bien de durcir les sanctions en matière de criminalité environnementale et exige que chaque pays européen transpose d’ici 2026 la directive de mars 2024 sur la protection pénale de l’environnement dans leurs législations nationales, en pratique ce droit de l’environnement demeure faible, peu pris en charge par les tribunaux déjà surchargés, alors que les nouvelles orientations globales qui se dessinent partout sous la pression des lobbies et de l’extrême droite annoncent de multiples retours en arrière. Tandis qu’au début des années 1990 la protection de l’environnement représentait 2 % de l’activité des tribunaux correctionnels, elle en représentait moins de 1 % dans les années 2010. Les débats et choix politiques qui entourent actuellement la question de l’OFB et de ses missions laissent par ailleurs de côté une série de questions fondamentales lorsqu’il s’agit de penser les transitions futures, celles de l’utilité des activités destructrices pour l’environnement, alors que, du réchauffement climatique aux pollutions globales, c’est bien leur existence qui est à la source des crises environnementales en cours.
Balistique de la dérégulation environnementale de l’agriculture à partir du sénateur Laurent Duplomb
Si l’industrie – nous l’avons vu – est un secteur qui bénéficie d’une forte impunité environnementale, l’agriculture se situe encore à un autre degré. Il ne s’agit pas seulement d’une capacité à se soustraire à la justice, mais d’un pouvoir de (dé)régulation, exercé en interne à la profession. Ceci correspond à une pratique inscrite dans l’histoire de la modernisation agricole depuis 1960 : la co-gestion des politiques publiques agricoles par le syndicalisme majoritaire (FNSEA et JA) au côté du ministère de l’Agriculture. Cette autorégulation fut intégrée comme une évidence sur le chemin du progrès productiviste et facilitée par les effets recherchés de cette modernisation : des campagnes vidées de leur substance sociale par l’exode rural et transformées en supports de production alimentaire pour une population de plus en plus ouvrière et urbaine qu’il fallait nourrir à bas coût, avec force engrais et pesticides. La co-gestion de l’agriculture française a été le cœur du réacteur qui a transformé le pays entier : remembrement faisant table rase de paysages séculaires pour calibrer les parcelles à l’échelle des tracteurs et de la productivité, passage d’une société paysanne à un pays industriel et urbain, révolution technologique qui a fait de la terre un outil de travail dont on mesure le rendement.
Depuis cette modernisation, la FNSEA et les JA ont régné sans partage sur les organisations professionnelles chargées de l’accès au métier et de son encadrement selon un modèle productiviste. Il fallut attendre les années 2000 pour que le pluralisme syndical soit reconnu et que le centre du pouvoir de décision des politiques agricoles se déplace de Paris à Bruxelles. Mais la possibilité d’expression du pluralisme est limitée par certains verrous (principe de prime à la majorité et liste d’union des deux centrales aux élections des chambres d’agriculture [18]), et la FNSEA a investi largement Bruxelles par une alliance avec les organisations représentant l’agro-industrie [19]. En outre, les relations tissées sur des décennies entre dirigeants syndicaux et organes du pouvoir politique demeurent sous la forme de réseaux d’influence, avec des effets bien réels sur la casse des réglementations environnementales, pourtant déjà fragiles et récentes.
La figure de Laurent Duplomb, ami et proche de Laurent Wauquiez [20], est une illustration de la collusion des pouvoirs, qu’ailleurs on qualifierait de conflits d’intérêts voire d’infiltration mafieuse. Ex-président de la chambre d’agriculture de Haute-Loire et ancien administrateur du groupe laitier Sodiaal, ce notable de la FNSEA siège à présent comme sénateur et s’attaque avec ardeur à l’OFB comme à « tous ces soldats verts du ministère de l’Écologie punitive » (DREAL, DDT) qu’il propose de « faire taire » ou « de supprimer [21] ». Ayant fait ses classes au syndicat des JA, il poursuit naturellement à la FNSEA, la centrale des aînés, et commence en parallèle une carrière politique comme adjoint municipal jusqu’à se hisser au Palais Bourbon en 2017. Il cumule, comme tous les dirigeants nationaux de la FNSEA, des mandats agricoles et politiques. Et il est de tous les combats anti-écolos : proposition de suppression de l’Agence BIO, attaque de l’ANSES [22] qu’il demande à placer sous l’autorité politique, et enfin dénigrement de l’OFB. L’attaque en règle contre les régulations environnementales de l’agriculture s’inscrit dans un projet cohérent plus large : permettre l’expansion et la prospérité du complexe agro-industriel liant les grandes exploitations exportatrices, les acteurs de l’amont (machinisme, fournisseurs d’engrais et de pesticides), les grandes coopératives (stock et export des grains, conseil et vente d’engrais et pesticides) et les acteurs de l’aval (transformation des matières premières en aliments ultra-transformés). Voilà pourquoi on attaque l’OFB et l’ANSES, en même temps que l’on réintroduit les néonicotinoïdes ou bien encore que le Parlement vote une dérogation à la loi EGalim (2018 [23]) qui prévoyait la séparation des activités de conseil et de vente de produits chimiques par une même structure pour éviter les conflits d’intérêts [24].
La trajectoire de certaines dispositions actuellement votées au Sénat suit les liens de collusion entre les dirigeants syndicaux et certains élus politiques – quand ce ne sont pas les mêmes. Repartons du rapport d’information du Sénat no 258, « La France, un champion agricole mondial : pour combien de temps encore ? », présenté par Laurent Duplomb en mai 2019 au sein de la commission des Affaires économiques. Ce rapport, peu diffusé hors des réseaux d’influence susmentionnés, contient déjà tout ce qui sera repris ensuite en termes de dérégulation et d’attaque des instances de protection de l’environnement et des consommateurs. Il s’agit d’un argumentaire précis, chiffré, qui explique que l’avenir de l’agriculture française – première productrice agricole européenne et largement exportatrice – est exposé à une concurrence internationale déloyale (préfigurant les mobilisations anti-Mercosur) à cause d’une sur-réglementation et d’une sur-transposition des normes européennes (en matière environnementale et sanitaire) (p. 11). Concernant la question du revenu des producteurs, « [p]rétendre régler le problème […] en ne traitant que la partie “GMS [25]” est une illusion ». Autrement dit, il ne faut pas, comme avec la loi EGalim de 2018, chercher à mieux partager la valeur entre producteurs et distributeurs (grande et moyenne surface). Au contraire, « [i]l convient de se préoccuper des autres sources de revenus que sont les subventions et aides et les revenus tirés de l’exportation » (p. 18). Ce qui revient à faire payer par les contribuables ce que les distributeurs et les transformateurs devraient verser aux producteurs. La loi EGalim est particulièrement épinglée en ce sens qu’elle ferait augmenter encore le coût de production des agriculteurs, notamment trois de ses mesures qui seront reprises dans les revendications pour être écornées ou supprimées : la création d’un différentiel de prix entre les produits phytopharmaceutiques et les produits autorisés dans l’agriculture biologique ; l’interdiction des remises, rabais et ristournes sur les produits phytopharmaceutiques ; la séparation des activités de vente et de conseil pour de tels produits (p. 12).
Le choc de simplification, déjà contenu dans ce document, a pour objectif la reconquête des marchés nationaux (contre les importations) et la conquête de nouveaux marchés « là où la demande va exploser », c’est-à-dire 150 pays d’Afrique et d’Asie qu’il reste « à conquérir », pour reprendre les termes parfaitement assumés du rapport. Concernant le marché national, la démocratie alimentaire promue par les partisans d’une alimentation saine et durable pour tous n’est pas le schéma retenu. Au contraire, « [p]rétendre vouloir sauver l’agriculture française uniquement par la montée en gamme est une illusion », car, affirme le rapport, les ménages pauvres n’y auront pas accès et se tourneront vers les importations. La solution est donc de « conserver la diversité de l’agriculture française capable de couvrir toutes les gammes ». Autrement dit, de permettre aux pauvres d’avoir accès à une malbouffe « made in France ». L’argument a été très bien accueilli par les lobbies de l’agroalimentaire et repris par la presse agricole ou nationale alignées sur les positions libérales et productivistes (Agriculture et Environnement, Xerfi Canal, Le Betteravier français, mais aussi Le Figaro [26]) dénonçant à l’unisson « le piège de la montée en gamme de l’agriculture ». Puisque l’agriculture bio est incapable de nourrir les Français, laissez-nous produire à grande échelle et à moindre coût pour le marché intérieur, mais aussi extérieur. Il s’agit en d’autres termes d’inverser les causes et les effets : le maintien de la consommation de produits bios dans une niche n’est pas le résultat d’un « choix du consommateur », mais le résultat d’une politique de sape du soutien au bio [27], de l’inégale répartition des aides PAC [28], et d’une politique d’austérité pour les ménages les moins aisés et de cadeaux fiscaux pour les plus riches, qui avantagent au final la production polluante à grande échelle et la consommation d’aliments ultra-transformés et nuisibles à la santé.
Les propositions de ce texte sont reprises dans le Pacte productif 2025 agricole présenté le 1er octobre 2019 par la FNSEA, l’Association nationale des industries alimentaires (ANIA) et Coop de France dans le cadre de la consultation lancée par Bruno Le Maire intitulée « Pacte productif 2025 pour le plein emploi ». Le rapport Duplomb apparaît d’ailleurs en page 5 pour marteler l’idée de menace que représente le recul des parts de marchés à l’export. On y retrouve l’importance d’une « approche pro-business » pour restaurer la confiance des acteurs économiques face à l’« agribashing », et l’enjeu principal de soutien à l’exportation, source de création d’emplois et de croissance du PIB, à condition de diminuer le coût du travail, des engrais, et d’en finir avec la sur-réglementation environnementale et sanitaire. La « fiscalité comportementale et environnementale » (taxes sur les boissons sucrées ou l’alcool, sur l’énergie), sans oublier l’interdiction de remises, rabais, ristournes sur les pesticides, sont épinglées tandis qu’est lancé un appel à lever les freins à l’innovation (mutagenèse, OGM, agri-énergie, etc.) et à permettre le stockage de l’eau (mégabassines). Dans une suite logique, le sénateur Laurent Duplomb présente une proposition de loi permettant un « choc de compétitivité en faveur de la ferme France », adoptée en première lecture par le Sénat en mai 2023. Outre l’assouplissement des mesures visant à limiter l’usage de pesticides, le texte propose de placer l’OFB sous le quasi-contrôle du préfet qui devra l’inciter à privilégier la procédure administrative et non judiciaire. Mais cette proposition de loi sera arrêtée par les péripéties gouvernementales (dissolution de l’assemblée, puis censure du Gouvernement).
Qu’à cela ne tienne, le texte revient en novembre 2024, toujours porté par le sénateur Laurent Duplomb sous le nom évocateur de « Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur no 108 ». Il s’agit d’une loi qui se veut complémentaire à la loi d’orientation agricole, initialement tournée vers le défi du renouvellement des actifs agricoles, le sénateur visant ainsi à s’assurer d’un volet pleinement orienté vers la dérégulation environnementale du secteur. Elle est adoptée au Sénat dès le 27 janvier 2025 grâce à une procédure accélérée engagée par le Gouvernement, mais reste, à l’heure où nous écrivons ces lignes, dans la navette parlementaire pour discussion et vote à l’Assemblée nationale. Quoi qu’il en soit, dans les rues, cette vulgate anti-régulation naviguant dans les réseaux syndicaux a fait son œuvre : les colères agricoles orchestrées par le syndicalisme majoritaire s’en prennent à l’OFB et à toutes les régulations environnementales qui deviennent le bouc émissaire des agriculteurs. Pourtant, ceux-ci sont-ils victimes du loup, de la réglementation sur les haies ou encore des entraves à l’exercice de leur métier que représenterait le maintien en vie des abeilles, des oiseaux et des insectes, ou bien, au contraire, de la chaîne agro-industrielle et exportatrice ? C’est en termes de collaboration à une destruction environnementale à grande échelle qu’il faut comprendre les relations qui unissent les agriculteurs à ce complexe. Si les plus riches en tirent des avantages, la plupart d’entre eux en sont les otages, souvent très endettés [29], ce qui peut expliquer la facilité avec laquelle on peut détourner leurs regards vers des cibles qui permettent de ne pas aborder de front les véritables responsabilités.
Ainsi, à partir de la fin 2024, faisant feu de tout bois sur la biodiversité et la santé des consommateurs, la commission des Affaires économique du Sénat, où pèse le sénateur Laurent Duplomb, va imprimer sa marque sur ces deux textes législatifs. Celui visant à « éviter les distorsions de concurrence » propose une série de dérégulations, comme la réautorisation de certaines substances dangereuses (néonicotinoïdes, acétamipride, etc. [30]) et l’inscription des mégabassines comme « intérêt général majeur [31] ». Cette loi s’attaque fortement à l’ANSES, notamment à son pouvoir d’autoriser ou non la mise sur le marché de certaines substances en donnant la possibilité au ministre de suspendre, par arrêté, une décision de l’agence sanitaire et en réorientant ses missions sur l’encouragement à « l’innovation par l’émergence de technologies nouvelles ».
Quant à la loi d’orientation agricole [32], elle marque une régression sans précédent sur le plan environnemental et une avancée majeure pour faire de l’agriculture un secteur économique prioritaire, maquillé sous les habits vertueux de la « souveraineté alimentaire » dont un récent rapport publié par l’association Terre de Liens [33] montre bien qu’elle a pourtant été largement sacrifiée sur l’autel du productivisme libéral. Là encore, c’est la commission des Affaires économique du Sénat qui a remanié le texte initial de l’Assemblée nationale et inscrit comme article premier un principe de « non-régression de la souveraineté alimentaire » en faisant de l’agriculture un « intérêt fondamental de la Nation ». Ceci a pour conséquence l’autorisation des mégabassines, le relâchement de toute entrave à la production, et la minorisation du rôle des instances de contrôle : l’OFB pour la biodiversité et l’ANSES pour les consommateurs. En bref, la non-régression de la compétitivité agricole justifie et autorise la régression totale de la santé du vivant.
Le pouvoir de police de l’OFB est réduit à peau de chagrin puisque le texte prévoit la dépénalisation quasi totale des atteintes à l’environnement par le secteur agricole. Désormais, l’arrachage de haies, l’usage de pesticides, l’épandage de lisiers ou le débordement de cuves de méthanisation ne pourront plus être poursuivis en pénal et la sanction financière sur le plan administratif passe de 150 000 euros à 450 euros. Cette peine minime ne s’applique qu’aux « cas intentionnels », ce qui restera difficile à prouver. Et si jamais les agents de l’OBF se risquaient encore à exercer leur fonction de police, les sénateurs ont inséré une « présomption de non-intentionnalité » pour certaines infractions. Justifiant cette impunité environnementale pour les agriculteurs, Laurent Duplomb a dénoncé sur Public Sénat le système prévalant jusqu’alors, où l’agriculteur faisant l’objet d’une poursuite pénale a « l’impression d’être un grand délinquant », ce que la ministre de l’Agriculture a appuyé en insistant sur « l’état d’insécurité juridique et de stress » dans lesquels se retrouvent les agriculteurs poursuivis.
À défaut d’inciter les agriculteurs à prendre le chemin de la transition agroécologique [34], cette loi aura au moins pour effet de faire entrer la délinquance environnementale dans le droit.
Les atteintes à l’environnement ne sont malheureusement pas l’apanage du secteur agro-industriel et agroalimentaire. L’agriculture a été la cible particulière et récente d’une dérégulation, car la période précédente avait vu quelques avancées en matière d’écologisation des pratiques, soutenues par la loi d’orientation agricole de 2014 et la loi EGalim. L’industrie, quant à elle, n’a pas opéré de transition écologique et les rares pouvoirs de police de l’environnement qui encadrent son activité sont bien minces face au chantage à l’emploi, aux menaces de délocalisation ou à l’inventivité de la chimie. Le maintien des polices de l’environnement en situation d’impuissance d’agir, leur affaiblissement récent et les dérégulations environnementales concernent aussi bien ce que nous avons dans nos assiettes (atteintes à l’ANSES), les forêts, les haies et la faune sauvage (atteintes à l’OFB), la lutte contre l’artificialisation des sols (loi Duplomb autorisant la construction sur sol agricole), la disponibilité en eau pour les humains et les écosystèmes (loi Duplomb et loi d’orientation agricole), que la vie des non humains et des humains (autorisation de pesticides considérés comme dangereux par la science). Cet ensemble de régressions ne peut qu’aggraver la crise écologique et climatique et sacrifie l’habitabilité de notre territoire au nom d’une prétention à nourrir le monde pour servir des profits qui ne concernent pas grand monde.
Notes
François Jarrige est maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université Bourgogne Europe, LIR3S. Il s’intéresse à l’histoire des sociétés industrielles et interroge les conflits, débats et controverses qui accompagnent les changements techniques et l’industrialisation de l’Occident.
Site : https://lir3s.u-bourgogne.fr/membres/jarrige-francois/
Yannick Sencébé est maîtresse de conférences en sociologie à AgroSup Dijon, CESAER.
Site : https://www2.dijon.inrae.fr/cesaer/membres/yannick-sencebe/

Pour citer cet article
François Jarrige
Yannick Sencébé
« Office français de la biodiversité. OFB et polices de l’environnement : le désarmement du droit », Vocabulaire critique et spéculatif des transitions [En ligne],
mis en ligne le 19/03/2025, consulté le 17/01/2026. URL : https://vocabulairedestransitions.fr/article-47.